
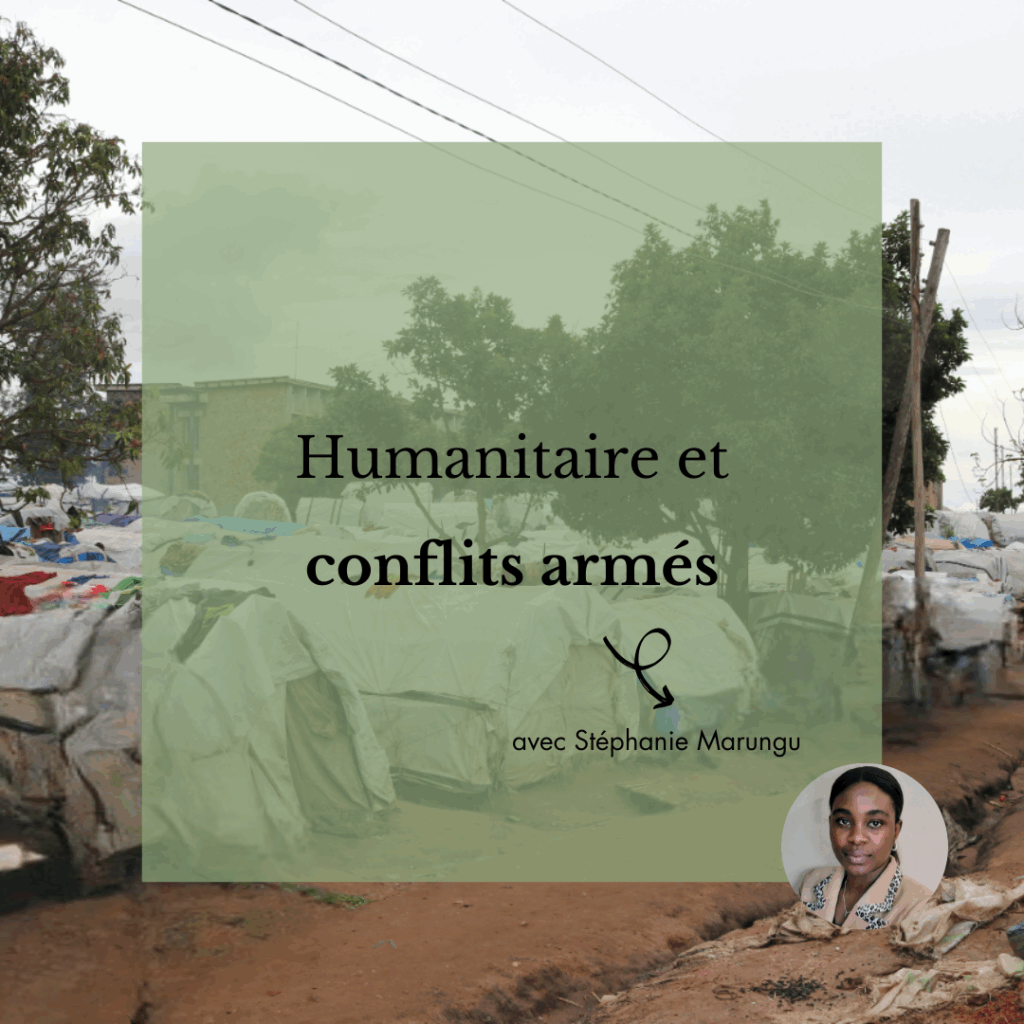
Dans les zones de conflit, l’action humanitaire se confronte à des défis extrêmes. La violence armée, l’insécurité permanente et la complexité des contextes rendent chaque intervention cruciale et dangereuse. Les travailleurs et travailleuses humanitaires doivent non seulement répondre aux besoins urgents des populations affectées mais aussi préserver leur neutralité, leur impartialité et leur sécurité sur le terrain. Et comment garantir cette sécurité et cette neutralité tout en répondant aux besoins urgents des civils, en particulier des femmes et des enfants ? Quels ajustements permettent de maintenir une action efficace malgré la violence et l’insécurité ? Pour analyser cela et essayer d’y répondre, j’ai eu le plaisir d’interviewer Stéphanie Marungu, coordinatrice de l’ONG Restoring Women Dignity/ REWODI. Son expérience en zone de conflit et auprès de communautés brisées par la violence l’a amenée à développer une expertise dans la réduction de la violence armée et la promotion de la paix.
Les effets de la violence sur les civils
Comme l’alerte Stéphanie, la violence armée mène au chaos et à l’effondrement de la société, des structures sociales et accentue les prémices d’une crise économique. Les civils se retrouvent dans une société sans repères, sans moyens de subsistance et avec l’obligation de fuir leur lieu de vie. Cela amène à des déplacements massifs de populations et à une multiplication des violences en tout genre. Ces violences sont davantage accentuées auprès de catégories de personnes vulnérables comme les femmes, les jeunes filles, les enfants ou encore les personnes âgées ou en situation de handicap. Les femmes et les jeunes filles sont la cible de violences sexuelles et basées sur le genre utilisées dans ce contexte comme une arme de guerre. Stéphanie illustre son propos en évoquant son expérience d’accompagnement auprès des femmes victimes de violences sexuelles, dont le nombre n’a cessé d’augmenter parallèlement à la montée des violences armées dans l’Est de la République Démocratique du Congo.
Ces violences sexuelles et basées sur le genre entraînent d’autres souffrances telles que la honte ou le rejet. Les femmes et jeunes filles victimes se voient stigmatisées par la société, abandonnées par leurs proches, portant parfois dans leurs bras un enfant né d’un viol.
Stéphanie attire également l’attention sur les enfants qui peuvent être contraints de rejoindre les forces armées. Privés d’école, arrachés à leur famille, ces enfants voient leur enfance leur être volée. Elle souligne aussi les risques dus aux mines non explosées, véritables pièges auxquels les enfants peuvent être exposés par inadvertance ou curiosité dans les zones de conflit. L’ONG Rewodi, en partenariat avec l’organisation internationale Street Child UK, a d’ailleurs mené le programme Endeleya afin d’accompagner les enfants victimes de la violence armée en répondant à leurs besoins éducatifs, psychosociaux et de protection. Un programme jugé nécessaire par Stéphanie, qui constate que la violence armée a affecté les enfants à un point tel qu’ils reproduisent la guerre dans leurs jeux. Elle termine en mettant en lumière le sort des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Laissées pour compte, elles subissent non seulement la violence directe mais aussi l’isolement et l’abandon. Privées de protection et de ressources, elles deviennent parmi les plus vulnérables et les plus fragiles face aux conséquences de la guerre.
Garantir l’accès et la sécurité
Pour Stéphanie, le plus grand défi demeure l’accès aux communautés qui ont le plus besoin d’aide. Et pour cause, les zones touchées par les conflits sont dangereuses et parfois même difficiles d’accès, rendant toute intervention extrêmement complexe. Pour y faire face, elle souligne l’importance de définir un cadre d’intervention clair, fondé sur le dialogue et la négociation avec les parties au conflit permettant ainsi aux organismes humanitaires d’avoir des garanties afin de pouvoir circuler et délivrer l’assistance nécessaire. Elle rappelle que, même lorsque les humanitaires sont amenés à échanger avec les acteurs étatiques ou groupes armés, ils se doivent de conserver une neutralité stricte, y compris dans l’assistance apportée aux communautés, afin de respecter leur mandat. Elle fait cependant remarquer que cette neutralité peut être mise à l’épreuve dans certaines situations de violence extrême.
« On ne prend pas parti, jamais. On ne dit pas que nous sommes de ce camp ou de l’autre camp. Notre seul camp est celui des civils, les civils en besoin. Et notre impartialité est ce qui nous donne un laissez-passer. Il nous permet de pouvoir nous déplacer et d’agir en toute sécurité. »
Stéphanie Marungu
Avant toute intervention sur le terrain, Stéphanie insiste sur la nécessité de mettre en place des mesures de sécurité. Elles passent par de longues négociations, l’obtention d’autorisations et de laissez-passer ainsi que par des garanties de protection fournies par les parties au conflit. Les organismes humanitaires instaurent aussi des protocoles stricts pour encadrer les déplacements et s’appuient sur des systèmes d’alerte destinés à signaler rapidement tout danger. L’objectif est de créer un cadre aussi sûr que possible pour le personnel. Elle rappelle cependant que, malgré les négociations avec les parties au conflit, la sécurité des humanitaires n’est jamais garantie. Les attaques, qu’elles soient délibérées ou non, restent un risque constant.
Impact et adaptation des programmes
Les humanitaires ne prennent pas part au conflit mais ils mènent un autre combat, faire face à l’urgence d’aujourd’hui et construire la paix de demain. Et dans un environnement marqué par la violence armée, assurer une aide efficace reste d’autant plus complexe que les populations affectées ont parfois du mal à se projeter dans l’avenir, comme tient à le souligner Stéphanie. La prise en compte de la santé mentale des populations est alors indispensable. Les traumatismes liés à la violence et à l’insécurité peuvent fragiliser leur capacité de résilience, limiter leur engagement dans les programmes et entraver le processus de reconstruction.
C’est précisément pour répondre à ces défis complexes que Stéphanie insiste sur l’importance d’une coordination étroite entre l’ensemble des acteurs de la région, afin de répondre au mieux aux besoins, notamment ceux des personnes les plus vulnérables. Parallèlement à ce travail de réponse immédiate, les acteurs humanitaires doivent poursuivre une évaluation continue des besoins pour s’adapter à l’évolution et à l’instabilité de l’environnement et envisager des projets de résilience. Elle ajoute enfin qu’il est essentiel de fournir des réponses réellement adaptées, en concertation avec les populations elles-mêmes, afin d’éviter toute forme d’assistanat et, surtout, de respecter leur dignité et leur droit de choisir leur destinée.
En zone de conflit, l’action humanitaire ne se limite pas à apporter une aide immédiate. Entre violence armée, insécurité permanente et populations traumatisées, les humanitaires doivent concilier urgence, sécurité, impartialité et écoute attentive des besoins. Comme le souligne Stéphanie, leur travail dépasse la simple distribution d’aide, il consiste à répondre aux besoins complexes des communautés, à prendre en compte leurs besoins psychosociaux et à mettre en place des programmes résilients. Plus qu’une réponse à la crise, leur action vise à construire un futur pacifié et durable.